Bien que la science-fiction soit plus fréquemment associée au roman, il arrive à la bande dessinée et à la poésie contemporaine de puiser dans des univers dystopiques.
Bien que la science-fiction soit plus fréquemment associée au roman, il arrive à la bande dessinée et à la poésie contemporaine de puiser dans des univers dystopiques.
La dystopie est une avenue relativement peu empruntée en bande dessinée québécoise, non pas en raison de ce – stérile – débat qui opposerait œuvres intimistes et de genre, mais par une pratique moins homogène, moins institutionnalisée de la science-fiction que ce que l’on peut retrouver chez les maisons d’édition européennes et américaines. Cela s’explique entre autres par le pouvoir commercial beaucoup plus important des grands éditeurs étrangers, qui peuvent se permettre de lancer un nombre exponentiel de séries, mais aussi par un public plus nombreux pour consommer ce type de littérature, souvent coûteuse à produire. Mais il ne faudrait pas croire que la dystopie s’avère complètement absente du paysage bédéistique québécois, ni que sa qualité soit à remettre en question; elle se présente, selon les influences variées des bédéistes, dans des propositions éclectiques.
Ab Irato, de Thierry Labrosse (Vents d’ouest, 2010-2015), est la série québécoise la plus fidèle à la bande dessinée de science-fiction classique européenne, tant dans sa facture visuelle que dans son traitement narratif. La prémisse du scénario est imprégnée d’un soupçon d’anti-terroir: le jeune héros, Riel Beauregard, quitte la campagne pour s’installer dans une Montréal corrompue où une fraction de personnes privilégiées profitent d’un vaccin rajeunissant, alors que le reste de la population doit lutter pour sa survie dans un monde sans merci. De son côté, Grégoire Bouchard est derrière le diptyque uchronique Le cauchemar argenté et Terminus, la Terre (Mosquito, 2017), dont l’action se déroule dans un Québec des années 1950 à la fois complètement américanisé et envahi par les Martiens. Plutôt que de plonger le lectorat dans une nostalgie positive de cet âge d’or de la BD, Bouchard dresse un portrait dérangeant de cette époque. Œuvre d’un dessinateur minutieux et consciencieux – voire maniaque des pitons, embranchements et autres gadgets –, la série est pétrie de réécritures de grands classiques de la science-fiction dans une reconfiguration de la société canadienne-française. D’ailleurs, comme le souligne Éric Bouchard dans la revue Planches1, l’auteur «sublime tout cet attirail référentiel pour installer sa voix propre: une espèce de spleen sophistiqué, crépusculaire, spectral».
Le Montréalais d’adoption François Vigneault, quant à lui, revisite l’héritage d’Ursula K. Le Guin dans son album Titan (Pow Pow, 2017), traduit par Alexandre Fontaine Rousseau. Vigneault présente les corps sans les idéaliser et développe une réflexion ouverte et inclusive sur les tensions raciales et les rapports de force de personnages marginalisés, incarnés dans ce cas-ci par une titanesque syndicaliste mélomane et un fonctionnaire brésilien sensible à la réalité des ouvrier·ères. Plus récemment, Le projet Shiatsung (Mécanique générale, 2019), premier album de Brigitte Archambault, s’est imposé comme un nouvel incontournable en matière de science-fiction dystopique québécoise, en renouvelant le genre de manière inattendue. Prisonnière d’une banlieue contrôlée par un programme informatique, l’héroïne du Projet Shiatsung, en cherchant à fuir un système béhavioriste, remet en question les fondements de notre humanité ainsi que de notre conditionnement social.
Le recours à la satire est aussi présent en bande dessinée dystopique, comme dans la trilogie Hiver nucléaire, de Cab (Front Froid, 2014-2018), un récit hivernal futuriste, truffé de clins d’œil humoristiques à Montréal, racontant les aventures d’une livreuse de bagels en motoneige, qui affronte un hiver montréalais permanent. De manière encore plus déjantée, La guerre des arts (Pow Pow, 2014), de Francis Desharnais, pousse le dystopique jusqu’à l’absurde en imaginant un futur où des extraterrestres auraient capturé tous les artistes de la Terre pour qu’ils et elles deviennent une arme létale infaillible dans l’espace. Par l’entremise d’un malicieux exercice de style, Desharnais duplique les seize mêmes cases sur une planche et n’en modifie que des détails et les dialogues. Cette esthétique minimaliste et répétitive développe, par la forme et le fun, une réflexion sur l’appréciation et les fonctions de l’art dans la société.
Quand le futur inspire une «poésie de genre»
Lorsqu’il est question de poésie dystopique, nous pouvons penser à des recueils qui mettent de l’avant une rencontre avec un univers post-apocalyptique, à l’instar de Mario Brassard dans son premier livre, publié aux Herbes rouges en 2003. Les tonalités futuristes et nihilistes des poèmes de Choix d’apocalypses entrent en phase avec certaines caractéristiques de la dystopie: «À l’époque où commence ce poème / Les nuages trouvent la terre bien longue». Mais est-ce que la poésie a la possibilité de plonger de manière plus marquée dans la science-fiction? Existe-t-il des démarches poétiques qui se revendiquent de la dystopie, des propositions qu’on pourrait peut-être qualifier de «poésie de genre»?
Pour tirer cette question au clair, nous avons rencontré Sylvie Bérard, professeure et chercheuse, autrice de science-fiction et de poésie. En naviguant entre plusieurs genres (à l’instar d’Élisabeth Vonarburg2, qu’elle cite en exemple lors de notre échange), Bérard distingue ses deux pratiques, celles de romancière et de poète, même si, selon elle, les premiers jets d’écriture «proviennent d’une même source». Elle revient sur l’incursion de la poésie dans sa prose, en citant son personnage d’Illyge Raimbault (La saga d’Illyge, Alire, 2011), qui s’exprime dans un style emprunté au slam, ainsi que sur l’imprégnation de ses influences science-fictives dans son univers poétique.
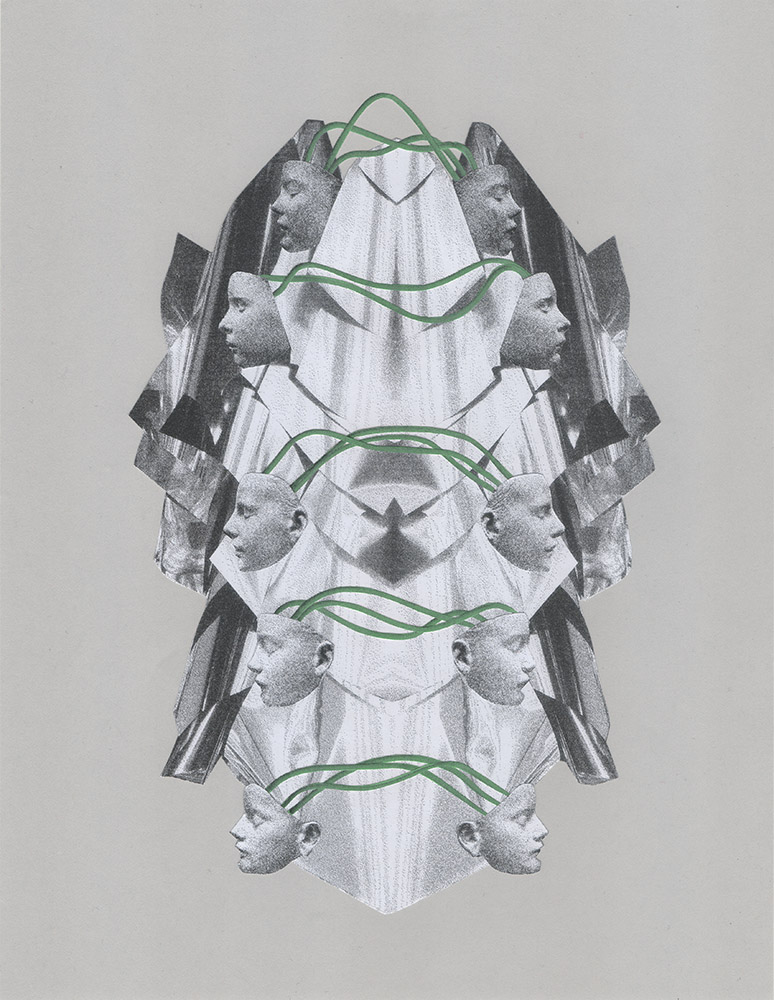
Collage : China Marsot-Wood
Dans un court article3 (La Peuplade, 2017). L’écrivaine y développe une «approche science-fictionnelle du vers4». Le livre, divisé en trois temporalités («Passé», «Présent», «Futur»), retrace l’évolution des machines, mais surtout la transformation des rapports entre les humains et les technologies, jusqu’à un futur éclaté où ces premiers ne sont plus l’espèce dominante.
La première section du recueil de Gaudet-Labine, qui se déroule sur la terre agricole familiale, expose le danger potentiel que représentent les machines pour les corps humains: «Moulin à faucher moissonneuse/batteuse/herse à dents/presse à/balles/épandeur semoir/planteuse/L’exposition agricole exige des protections». Ce risque est relié à l’exercice des gestes qui, à la fois, perpétuent la vie à la ferme et permettent à l’humanité de régner sur son environnement. Ce rapport de domination, dans lequel l’humain instrumentalise la nature par le biais de la technologie moderne, est rapidement inversé au profit de technologies plus performantes. Ainsi, dans la seconde partie du livre, les machines, même si elles sont utilisées au quotidien, prennent de plus en plus le contrôle de l’identité de la narratrice, jusqu’à la priver de sa capacité à s’énoncer: «Le pouls curseur/clignote/guet-apens/avalant/un à un/mes mots».
La dernière partie du recueil pousse plus loin le travail poétique sur le langage par l’exploration de la société dystopique dans laquelle est plongée la narratrice. À ce stade, les technologies semblent si menaçantes que le je narrant s’exprime parfois en MERU, un «langage clandestin développé autour de 2050». Gaudet-Labine utilise de surcroît la note en bas de page pour traduire un poème du MERU au français, lecture croisée qui montre la transmutation des référents. Une transmutation qui frappe aussi la narratrice du recueil, soumise à la «Grande Captation Numérique». À sa voix s’entremêle le langage des machines, dont les consciences ont été développées. Celles-ci lui demandent: «Qui suis-je/humaine?». Une question qui appelle une perspective poétique pour envisager un avenir possiblement transhumaniste.
Ambiance sonore, poésie et conscience en téléchargement
À la manière d’un band de musique qui se réfugie dans un chalet isolé pour enregistrer un premier EP, un collectif de poètes et de musiciens s’est rassemblé pour donner vie à un objet multidisciplinaire qui trace le parcours de quatre personnages dans un univers post-apocalyptique. Lancé le 12 mai 2020 sur la plateforme Bandcamp, le projet On a pas mangé de framboises depuis 1266 jours s’accordait avec le climat pandémique printanier – ce que les instigateurs, le poète Mathieu Renaud et le musicien Pierre-Luc Clément, n’avaient certainement pas pu prévoir. Se sont joints au duo les poètes Marjolaine Beauchamp, Alexandre Dostie, JF No et Maude Veilleux, qui ont donné vie à des personnages (respectivement la mère, le cow-boy, le mégalomane et l’amoureuse des machines), certains évoluant dans un Montréal mortifère: «l’île stune tank de fuel/le pire est à venir/as-tu du feu/qu’a dit pour qu’on rie un peu/dans le no man’s land» (Alexandre Dostie), d’autres téléchargeant leurs consciences vers un «Eden 2.0» (Mathieu Renaud).
Si les rôles des protagonistes sont façonnés dans une démarche de relecture science-fictive, ils ont surtout été inspirés par la véritable (!) histoire d’anciens chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ayant mis au point une technique d’embaumement permettant de conserver intact le cerveau, et ce, dans l’espoir que l’on soit un jour capable de le numériser et de le télécharger dans un support numérique. Un service vendu par une jeune entreprise pour la modique somme de 10000$, et qui aurait déjà été consommé par une première cliente (et non, il ne s’agit pas de la narratrice du recueil d’Isabelle Gaudet-Labine).
Décrit comme un «opéra rock sans rock et sans opéra», On a pas mangé de framboises depuis 1266 jours incorpore une dimension performative propre aux poètes de l’Écrou. On aurait pu craindre qu’une intrigue définie en amont ne nuise à l’envergure poétique du projet, soit en gommant les particularités des artistes au profit du propos collectif – il n’en est rien – ou en alourdissant les textes. Au contraire, une justesse étonnamment familière s’en dégage: «les humains coulent/se déchirent / le beau disparait/fuck […]/je dois l’avouer je préfère les machines/pas d’égo / elles ne demandent rien / elles offrent/les machines nous sauvent/fuck» (Maude Veilleux).
Des discussions sont en cours pour présenter ce projet en salle; reste à voir si, en temps de pandémie, le propos d’On n’a pas mangé de framboises n’est pas prophétique, et si nous n’aurons pas à télécharger nos consciences vers un ailleurs numérique afin d’y assister…
Peut-on imaginer d’autres horizons littéraires pour la dystopie? Le climat actuel saura certainement inspirer des œuvres qui prendront des formes multiples, emploieront des moyens inattendus pour atteindre leurs publics. L’avenir littéraire québécois peut compter sur une pratique dynamique de l’écriture dystopique qui, polymorphe, ne se limite pas à la prose et aux canons du genre dans l’optique de se renouveler.
Virginie Fournier est autrice, poète, critique (notamment à LQ) et libraire spécialisée en bande dessinée. Elle s’intéresse particulièrement à l’histoire littéraire des femmes, à l’édition indépendante et aux arts imprimés. Elle a publié également dans les revues Boulette, Mœbius et Tristesse.
- 1. Éric Bouchard, «Relectures: Vers les mondes lointains de Grégoire Bouchard», Planches, avril2017, no10, p.33.
- 2. NDLR: Élisabeth Vonarburg signe un texte dans le présent dossier.
- 3. Sylvie Bérard, «Poésie littérale et science-fiction métaphorique», Participe présent. Bulletin de l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français, no 79, été 2020, p.22. publié dans Participe présent, Sylvie Bérard s’appuie sur la notion de métaphore, figure généralement associée à la poésie, afin de décrire le travail d’écriture en science-fiction: «À l’inverse de la poésie et à l’instar de la science peut-être, la science-fiction se sert d’analogies, de métaphores filées et d’autres allégories à fonction similaire, non pas pour dire plus que ce que le texte ne dit, mais pour appréhender une autre réalité.»
Cette réflexion est intéressante à mettre en parallèle avec le recueil Nous rêvions de robots, d’Isabelle Gaudet-Labine
Isabelle Gaudet-Labine est la poète invitée de ce numéro. - 4. Citation extraite d’une page consacrée à Isabelle Gaudet-Labine sur le site du Congrès Boréal [congresboreal.ca].

