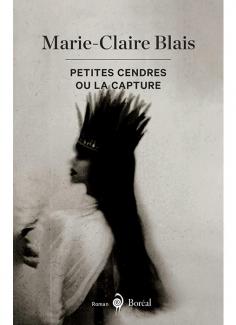Si toute chose a une fin, comme le prétend l’adage populaire, il arrive que d’excellentes n’en aient pas. Le onzième volume du cycle Soifs, en plus de s’ajouter au décalogue que l’on croyait clos, a le bon goût d’être, comme ses prédécesseurs, du raffinement des grands crus.

Si toute chose a une fin, comme le prétend l’adage populaire, il arrive que d’excellentes n’en aient pas. Le onzième volume du cycle Soifs, en plus de s’ajouter au décalogue que l’on croyait clos, a le bon goût d’être, comme ses prédécesseurs, du raffinement des grands crus.
Pour ceux et celles qui ne seraient pas encore au parfum du secret le mieux gardé des lettres québécoises, chacun des tomes de cette œuvre-fleuve peut être lu tant dans l’ordre de parution qu’à la fantaisie de ses envies. Voyez ma propre errance : je me suis d’abord attaqué au premier, puis au deuxième, pour ensuite faire un bond quasi quantique jusqu’aux dixième et onzième volumes. Le prochain sur ma liste devrait me ramener au troisième. Ma lecture n’en a pas été moins riche. Cela tient en partie à cette forme atypique qui est devenue le sceau recherché chez Blais : une collision (pour ne pas dire un maelstrom) de flux de pensées se frottant les unes aux autres jusqu’à embraser les neurones du lecteur qui, dans l’exercice, mêle cette matière dans une alchimie de synapses, laquelle relève tant de la symphonie que du champ de bataille. Le feu d’artifice ne s’adresse pas aux sens, mais s’efforce plutôt d’en extirper de cette schizophrénie scrupuleusement ordonnée.
Chaque volume est comme la zone circonscrite par un télescope que l’on braquerait sur l’immense galaxie qu’est le cycle Soifs. Les thèmes comme les personnages reviennent ; certains de ces derniers, plus centraux que d’autres, font figure d’astres incandescents autour desquels gravitent d’autres corps célestes de moindre importance. Bien sûr, temps et actions existent et bouleversent à bon rythme ce monde toujours en mouvement, mais nous sommes à des lieux du roman à suspense exigeant le mystère sur certaines de ses révélations pour préserver l’expérience de lecture. La matière du cycle Soifs est si dense, si animée qu’elle possède la force démiurgique du big bang, et ce, peu importe par quel bout on a la fantaisie de l’examiner.
Le brasier incandescent des luttes inachevées
Les habitués de la série auront le bonheur de retrouver Petites Cendres, Robbie et Yinn, toutes trois survivantes miraculées de l’effroyable attentat qui avait décimé la communauté LGBTQ+ de l’île à la fin du dixième tome (Une réunion près de la mer, Boréal, 2018). Le filon central de Petites Cendres ou la capture est d’ailleurs, vous l’aurez deviné d’après le titre, l’entreprise de sauvetage du vieux Noir Grégoire par la trans Petites Cendres. Plutôt éméché, Grégoire ne résiste pas à la tentation d’insulter vertement un policier blanc au beau milieu de la nuit. Trouvant en cet homme le représentant de toutes les atrocités commises par les Blancs à travers l’histoire, Grégoire devient le porte-parole embrasé des opprimés séculaires, l’écho en colère de luttes ataviques. D’abord indulgent, le policier ne tarde pas à prendre la mouche, accumulant le fiel comme d’autres enrichissent l’uranium afin de créer la bombe atomique. Son vernis de professionnalisme se craquelle au rythme où sa pensée s’emballe. Petites Cendres s’impose alors, par son seul rôle de témoin embarrassant, comme le rempart contre la violence à peine contenue du suprémaciste mal caché sous l’uniforme.
En un viol comme en cent
De nombreuses autres rigoles ruissellent de ce flot principal, rivalisant parfois même avec son impétuosité. Parmi les plus puissantes, il y a l’horrible nuit de Love, jeune Américano-Vietnamienne venue sur l’île célébrer la fin des classes en compagnie de ses amis d’enfance Nathan et Martin. D’une violence inouïe, ce passage insoutenable décrit en long et en large le viol, par les deux hommes, de leur supposée compagne de voyage. On y lit l’expression la plus abjecte qui soit de la jalousie de l’homme blanc pour le succès arraché de haute lutte sur l’immigrée ainsi que l’instinct bestial de salir, de casser, de dominer, qui semble être l’essence même du legs génétique et culturel des pâles bourreaux. Brillante description de la complaisance de la société et des institutions à l’endroit de ces jeunes de bonne famille commettant des forfaits impardonnables, cet extrait fait écho aux œuvres sœurs de Karine Tuil (Les choses humaines, Gallimard, 2019) et de Virginie Despentes (Vernon Subutex, Grasset, 2015; 2017).
La vie abonde en ces pages, et l’espace ici donné ne suffit pas à rendre justice à tous ces personnages qui laissent chacun leurs coups de griffe sur nos mémoires. La tentation est grande, devant l’injustice systémique et la constance de l’atrocité, de faire comme Robbie et de partir au loin cultiver son jardin. Réfugiée en Alaska après le traumatisme de l’attentat, la fêtarde flamboyante a pris le parti de se retirer du monde, à défaut de pouvoir le changer, et d’en recréer un plus petit, idéal, dérisoire et salutaire. Un monde miniature à dessiner à son image, sur lequel il serait possible d’avoir prise tout en s’accommodant de ses inévitables défauts. Côtoyés depuis si longtemps, n’apparaissent-ils pas comme de vieux amis avec lesquels il est facile de transiger ?